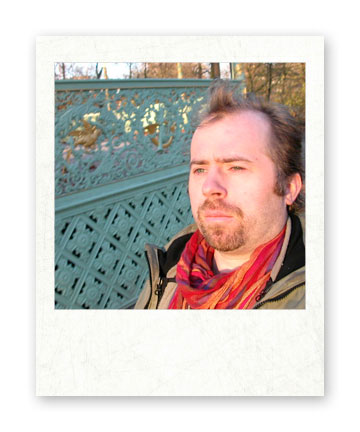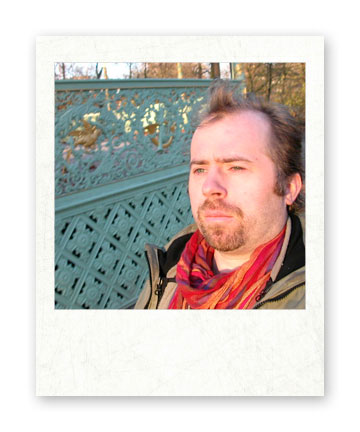
C’est comme si j’avais atteint la face cachée de la lune, traversé l’Atlantique à la rame, escaladé les lacets de l’Alpe d’Huez et je ne souhaite à personne d’être dans le même état que moi aujourd’hui.
A l’accorte jeune fille qui sert les cafés chez Filigranes – où j’ai passé l’après-midi à revoir des visages connus – cette série en cours doit avoir un sens – et qui me demandait ce que je voulais, j’ai commandé le plus sérieusement du monde et en le pensant sincèrement « je voudrais un café et un sens à ma vie ».
Depuis que j’ai découvert que je suis plutôt bon pour aligner des mots qui forment des phrases qui se jettent dans des paragraphes qui eux-mêmes arrivent fluvialement en delta ou en embouchure à former des textes plus ou moins longs, j’ai pour ambition de clôturer un texte de fiction, quelque chose d’ambitieux, quelque chose de publiable, quelque chose dont je sois fier.
Ça, c’est fait.
Et la littérature ne devrait pas avoir le droit de faire ça à quiconque. C’est la première fois que je rencontre le post-partum blues littéraire, qui est paraît-il « normal ». Je le prend comme un direct du droit en pleine figure, comme une rencontre nocturne et mal famée avec un champion du monde catégorie poids lourds.
J’ai eu l’impression de me réveiller lundi alors qu’on est dimanche. J’ai l’impression d’être une éponge qui a été tordue, essorée le nombre suffisant de fois pour en expulser toute trace de jus. J’ai terminé un texte de fiction que je juge éditable et aujourd’hui ça me met dans un état proche de l’Ohio.
La distributrice de café de Filigranes ne m’en fournissant pas un, j’ai été me chercher un sens à ma vie au Parc Royal. Et le plus étonnant c’est que j’en ai trouvé un. Pas original mais puissant. Seulement voilà, pour concrétiser ce projet, il me faudra trouver une muse.
A suivre.